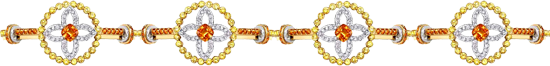Jadis, à mon adolescence je faisais du théâtre pour mon propre plaisir personnel. J'apprenais des scènes de diverses pièces classiques comme "Le Cid', "L'Avare", "Les fourberies de Scapin", "Esther"... J'apprenais aussi des poésies de divers auteurs. Aussi, j'ai tenu à vous faire connaitre par cette page certaines poésies que j'avais récités en public.


Il y a dans les arts, autre chose
que le savoir technique, l'habileté
spéciale, la connaissance et la possession, même parfaites, des
procédés : tout cela est bien et même absolument nécessaire
; mais tout cela ne constitue que les matériaux de
l'artiste, l'enveloppe et le corps d'un art particulier et
déterminé. Dans tous les arts, il y a quelque chose qui n'appartient
exclusivement à aucun et qui est commun à
tous, au-dessus de tous, et sans quoi ils ne sont plus que de
simples métiers; ce quelque chose qui ne se voit pas, mais
qui est l'âme de la vie, c'est l'Art.
L'art, est une des trois grandes transformations que subissent les réalités au contact de l'esprit humain, selon qu'il les considère à la lumière idéale et souveraine de l'un des trois grands aspects du Bien, du vrai et du beau.
L'art, n'est pas plus un rêve pur qu'il n'est une pure copie ; il n'est ni l'Idéal seul, ni le réel seul ; il est ainsi que l'homme lui-même, la rencontre, l'union des deux. Il est l'unité dans la dualité. Par l'Idéal seul, ilest au-dessus de nous ; Par le réel seul, il reste au-dessous.
La morale est l'humanisation, l'incarnation du bien ; la Science est celle du Vrai ; l'Art est celle du Beau.
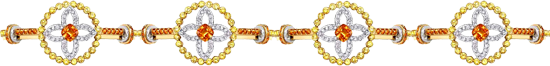

On ne voit en passant par les landes désertes,
Vrai Sahara français, poudré de sable blanc,
Surgir de l'herbe sèche et flaques d'eau vertes,
D'autre arbre que le pin avec sa plaie au flanc.
Car, pour lui dérober ses larmes de résine,
L'homme, avare bourreau de la création,
Qui ne vit qu'aux dépens de ceux qu'il assassine,
Dans son tronc douloureux ouvre un large sillon !
Sans regretter son sang qui coule goutte à goutte,
Le pin verse son baume et sa sève qui bout,
Et se tient toujours droit sur le bord de la route,
Comme un soldat blessé qui veut mourir debout.
Le poète est ainsi dans les landes du monde ;
Lorsqu'il est dans la blessure, il garde son trésor.
Il faut qu'il ait au coeur une entaille profonde,
Pour épancher ses vers, divines larmes d'or !
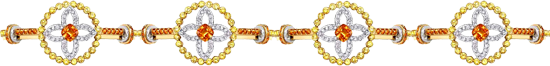

- Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ? Ton père, ta mère, ta soeur, ou ton frère ?
- Je n'ai ni père, ni mère, ni soeur, ni frère.
- Tes amis ?
- Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu.
- Ta patrie ?
- J'ignore sous quelle lattitude est est située.
- La beauté ?
- Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle.
- L'or ?
- Je le hais, comme vous haïssez Dieu.
- Eh ! qu'aimes-tu donc extraordinaire étranger ?
- J'aime les nuages... Les nuages qui passent... Là-bas... Là-bas...
Les merveilleux nuages !
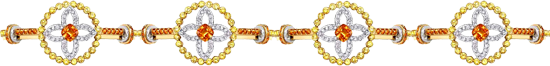

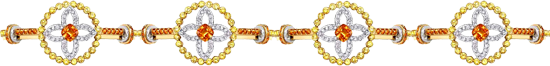

Pâle étoile du soir, messagère lointaine,
Dont le front sort brillant des voiles du couchant ;
De ton palais d'azur au sein dur firmament
Que regardes-tu dans la pleine ?
La tempête s'éloigne et les vents sont calmés.
La forêt, qui frémit, pleure sur la bruyère ;
Le phalène doré, dans sa course légère,
Traverse les prés embaumés.
Que cherches-tu sur la terre endormie ?
Mais déjà sur les monts je te vois t'abaisser ;
Tu fuis en souriant, mélancolique amie,
Et ton tremblant regard est près de s'effacer.
Etoile qui descends sur la verte colline,
Triste larme d'argent du manteau de la nuit,
Toi, que regarded au loin le pâtre qui chemine,
Tandis que pas à pas son long troupeau le suit :
Etoile, où t'en vas-tu dans cette nuit immense ?
Cherches-tu sur la rive un lit dans les roseaux ?
Où t'en vas-tu si belle, à l'heure du silence,
Tomber comme une perle au sein profond des eaux ?
Ah ! si tu dois mourir, bel astre, si ta tête
Va dans la vaste mer plonger ses blonds cheveux,
Avant de nous quitter, un seul instant arrête ;
Etoile de l'amour, ne descends pas des cieux !
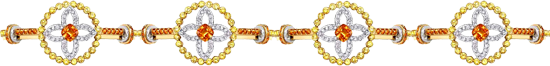

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle,
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que de l'horizon embrassant tout le cercle,
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits.
Quand la terre est changée en un cachot humide,
Où l'espérance, comme une chauve souris,
S'en va battant les murs de son aile timide,
Et se cognant la tête à des plafonds pourris ;
Quand la pluie étalant ses immenses trainées,
D'une vaste prison imite les barreaux,
Et qu'un peuple muet d'infames arraignées,
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux.
Des cloches tout à coup sautent avec furies,
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,
Ainsi que des esprits errants et sans patrie,
Qui se mettent à geindre opiniatrement.
Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,
Défilent lentement dans mon âme ; l'espoir
Vaincu, pleure, et l'angoisse atroce despotique,
Sur mon crane incliné, plante son drapeau noir.
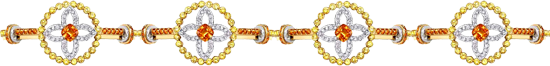

Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme,
Où dans l'air énervé flotte du repentir,
Où sur la vague lente et lourde d'un soupir,
Le coeur le plus secret aux lèvres vient mourir.
Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme,
Et, ces soirs là, je vais tendre comme une femme.
Il est de clairs matins, de roses se coiffant,
Où l'âme a des gaités d'eaux vives dans les roches,
Où le coeur est un ciel de Pâques plein de cloches,
Où la chair est sans tache et l'esprit sans reproches.
Il est de clairs matins, de roses se coiffant,
Ces matins là, je vais joyeux comme un enfant.
Il est de mornes jours où, làs de se connaitre,
Le coeur, vieux de mille ans, s'assied sur son butin,
Où le plus cher passé semble un décor déteint,
Où s'agite un vague et minable cabotin.
Il est de mornes jours, las du poids de connaitre,
Et, ces jours là, je vais courbé comme un ancêtre.
Il est des nuits de doute ou l'angoisse vous tord,
Où l'âme, au bout de la spirale descendue,
Pâle est sur l'infini terrible suspendue,
Sent le vent de l'abime et recule éperdue !
Il est des nuits de doute où l'angoisse vous tord,
Et, ces nuits là, je suis dans l'ombre comme un mort.
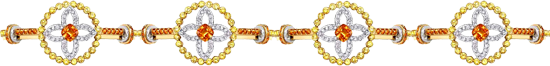


L'art, est une des trois grandes transformations que subissent les réalités au contact de l'esprit humain, selon qu'il les considère à la lumière idéale et souveraine de l'un des trois grands aspects du Bien, du vrai et du beau.
L'art, n'est pas plus un rêve pur qu'il n'est une pure copie ; il n'est ni l'Idéal seul, ni le réel seul ; il est ainsi que l'homme lui-même, la rencontre, l'union des deux. Il est l'unité dans la dualité. Par l'Idéal seul, ilest au-dessus de nous ; Par le réel seul, il reste au-dessous.
La morale est l'humanisation, l'incarnation du bien ; la Science est celle du Vrai ; l'Art est celle du Beau.
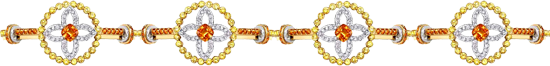

On ne voit en passant par les landes désertes,
Vrai Sahara français, poudré de sable blanc,
Surgir de l'herbe sèche et flaques d'eau vertes,
D'autre arbre que le pin avec sa plaie au flanc.
Car, pour lui dérober ses larmes de résine,
L'homme, avare bourreau de la création,
Qui ne vit qu'aux dépens de ceux qu'il assassine,
Dans son tronc douloureux ouvre un large sillon !
Sans regretter son sang qui coule goutte à goutte,
Le pin verse son baume et sa sève qui bout,
Et se tient toujours droit sur le bord de la route,
Comme un soldat blessé qui veut mourir debout.
Le poète est ainsi dans les landes du monde ;
Lorsqu'il est dans la blessure, il garde son trésor.
Il faut qu'il ait au coeur une entaille profonde,
Pour épancher ses vers, divines larmes d'or !
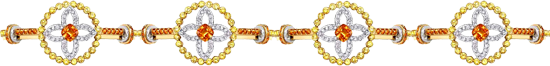

- Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ? Ton père, ta mère, ta soeur, ou ton frère ?
- Je n'ai ni père, ni mère, ni soeur, ni frère.
- Tes amis ?
- Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu.
- Ta patrie ?
- J'ignore sous quelle lattitude est est située.
- La beauté ?
- Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle.
- L'or ?
- Je le hais, comme vous haïssez Dieu.
- Eh ! qu'aimes-tu donc extraordinaire étranger ?
- J'aime les nuages... Les nuages qui passent... Là-bas... Là-bas...
Les merveilleux nuages !
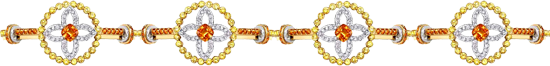

C'est parce que je roule en moi
ces choses sombres,
C'est parce que je vois l'aube dans les décombres,
Sur les trônes le mal, sur les autels la nuit,
Bravant tout ce qui règne, aimant tout ce qui souffre ;
C'est parce que je suis parfois, mage inclément,
Sachant que la clarté trompe et que le bruit ment,
Tenté de reprocher aux cieux visionnaires,
Leur crachement d'éclairs et leur toux de tonnerre ;
C'est parce que mon coeur, qui cherche son chemin,
N'accepte le divin qu'autant qu'il est humain ;
C'est à cause des tous ces songes formidables,
Que je m'en vais, sinistre, aux lieux inabordables,
Au bord des mers, au haut des monts, au fond des bois.
Là, j'entends mieux crier l'âme humaine aux abois :
Là, je suis pénétré plus avant par l'idée
Terrible, et cependant de rayons innondée.
Méditer, c'est le grand devoir mystérieux ;
Les rêves dans nos coeurs s'ouvrent comme des yeux,
Je rêve et je médite, et c'est pourquoi j'habite,
Comme celui qui guette une lumière subite,
Le désert et non pas les villes ; c'est pourquoi,
Sauvage serviteur du droit contre la loi,
Laissant derrière moi les molles cités pleines
De femmes et de fleurs qui mêlent leurs haleines,
Et les palais de rires et de festins,
De danses, de plaisirs, de feux jamais éteints,
Je fuis, et je préfère à toute cette fête,
La rive du torrent farouche, où le prophète
Vient boire dans le creux de sa main en été,
Pendant que le lion boit de l'autre côté.
C'est parce que je vois l'aube dans les décombres,
Sur les trônes le mal, sur les autels la nuit,
Bravant tout ce qui règne, aimant tout ce qui souffre ;
C'est parce que je suis parfois, mage inclément,
Sachant que la clarté trompe et que le bruit ment,
Tenté de reprocher aux cieux visionnaires,
Leur crachement d'éclairs et leur toux de tonnerre ;
C'est parce que mon coeur, qui cherche son chemin,
N'accepte le divin qu'autant qu'il est humain ;
C'est à cause des tous ces songes formidables,
Que je m'en vais, sinistre, aux lieux inabordables,
Au bord des mers, au haut des monts, au fond des bois.
Là, j'entends mieux crier l'âme humaine aux abois :
Là, je suis pénétré plus avant par l'idée
Terrible, et cependant de rayons innondée.
Méditer, c'est le grand devoir mystérieux ;
Les rêves dans nos coeurs s'ouvrent comme des yeux,
Je rêve et je médite, et c'est pourquoi j'habite,
Comme celui qui guette une lumière subite,
Le désert et non pas les villes ; c'est pourquoi,
Sauvage serviteur du droit contre la loi,
Laissant derrière moi les molles cités pleines
De femmes et de fleurs qui mêlent leurs haleines,
Et les palais de rires et de festins,
De danses, de plaisirs, de feux jamais éteints,
Je fuis, et je préfère à toute cette fête,
La rive du torrent farouche, où le prophète
Vient boire dans le creux de sa main en été,
Pendant que le lion boit de l'autre côté.
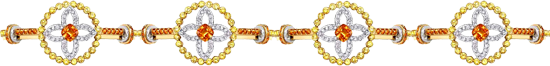

Pâle étoile du soir, messagère lointaine,
Dont le front sort brillant des voiles du couchant ;
De ton palais d'azur au sein dur firmament
Que regardes-tu dans la pleine ?
La tempête s'éloigne et les vents sont calmés.
La forêt, qui frémit, pleure sur la bruyère ;
Le phalène doré, dans sa course légère,
Traverse les prés embaumés.
Que cherches-tu sur la terre endormie ?
Mais déjà sur les monts je te vois t'abaisser ;
Tu fuis en souriant, mélancolique amie,
Et ton tremblant regard est près de s'effacer.
Etoile qui descends sur la verte colline,
Triste larme d'argent du manteau de la nuit,
Toi, que regarded au loin le pâtre qui chemine,
Tandis que pas à pas son long troupeau le suit :
Etoile, où t'en vas-tu dans cette nuit immense ?
Cherches-tu sur la rive un lit dans les roseaux ?
Où t'en vas-tu si belle, à l'heure du silence,
Tomber comme une perle au sein profond des eaux ?
Ah ! si tu dois mourir, bel astre, si ta tête
Va dans la vaste mer plonger ses blonds cheveux,
Avant de nous quitter, un seul instant arrête ;
Etoile de l'amour, ne descends pas des cieux !
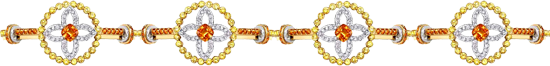

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle,
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que de l'horizon embrassant tout le cercle,
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits.
Quand la terre est changée en un cachot humide,
Où l'espérance, comme une chauve souris,
S'en va battant les murs de son aile timide,
Et se cognant la tête à des plafonds pourris ;
Quand la pluie étalant ses immenses trainées,
D'une vaste prison imite les barreaux,
Et qu'un peuple muet d'infames arraignées,
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux.
Des cloches tout à coup sautent avec furies,
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,
Ainsi que des esprits errants et sans patrie,
Qui se mettent à geindre opiniatrement.
Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,
Défilent lentement dans mon âme ; l'espoir
Vaincu, pleure, et l'angoisse atroce despotique,
Sur mon crane incliné, plante son drapeau noir.
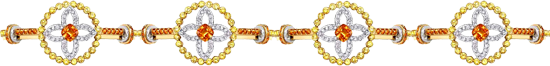

Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme,
Où dans l'air énervé flotte du repentir,
Où sur la vague lente et lourde d'un soupir,
Le coeur le plus secret aux lèvres vient mourir.
Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme,
Et, ces soirs là, je vais tendre comme une femme.
Il est de clairs matins, de roses se coiffant,
Où l'âme a des gaités d'eaux vives dans les roches,
Où le coeur est un ciel de Pâques plein de cloches,
Où la chair est sans tache et l'esprit sans reproches.
Il est de clairs matins, de roses se coiffant,
Ces matins là, je vais joyeux comme un enfant.
Il est de mornes jours où, làs de se connaitre,
Le coeur, vieux de mille ans, s'assied sur son butin,
Où le plus cher passé semble un décor déteint,
Où s'agite un vague et minable cabotin.
Il est de mornes jours, las du poids de connaitre,
Et, ces jours là, je vais courbé comme un ancêtre.
Il est des nuits de doute ou l'angoisse vous tord,
Où l'âme, au bout de la spirale descendue,
Pâle est sur l'infini terrible suspendue,
Sent le vent de l'abime et recule éperdue !
Il est des nuits de doute où l'angoisse vous tord,
Et, ces nuits là, je suis dans l'ombre comme un mort.
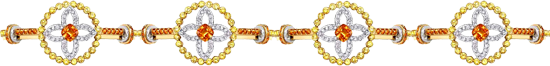

Il y a des hommes
océans, en effet.
Ces ondes, ce flux et ce reflux,
ce va et vient terrible, ce bruit de tous les souffles, ces noirceurs
et ces transparences, ces végétations propres au
gouffre, cette démagogie des nuées en plein
ouragan, ces aigles dans l'écume, ces merveilleux levers
d'astres répercutés dans on ne sait quel
mystérieux tumultes par des millions de cimes lumineuses,
têtes confuses de l'innombrable, ces grandes foudres errantes
qui semblent guetter, ces sanglots énormes, ces monstres
entrevus, ces nuits de ténèbres
coupées de rugissement, ces furies, ces
frénésies, ces tourmentes, ces roches, ces
nauffrages, ces flottes qui se heurtent, ces tonnerres humains
mêlés aux tonnerres divins, ce sang dans l'abime ;
Puis, ces grâces, ces douceurs, ces fêtes, ces
gaies voiles blanches, ces bâteaux de pêche, ces
chants dans le fracas, ces ports splendides, ces fumées de
la terre, ces villes à l'horizon, ce bleu profond de l'eau
et du ciel, cette âcreté utile, cette amertume qui
fait l'assainissement de l'Univers, cet âpre sel sans lequel
tout pourrirait ; ces colères et ses apaisements, ce tout
dans Un, cet inattendu dans l'immuable, ce vaste prodige de la
monotonie inépuisablement variée, ce niveau
après ce bouleversement, ces enfers et ces paradis de
l'immensité éternellement émue, cet
insondable, tout cela peut-être dans un esprit, et alors cet
esprit s'appelle génie, et vous avez Eschyle, vous avez
Isaïe, vous avez Juvénal, vous avez Dante, vous
avez Michel-Ange, vous avez Shakespeare, et c'est la même
chose de regarder ces âmes ou de regarder l'Océan.
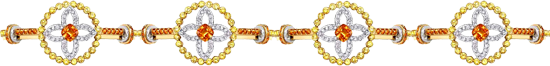

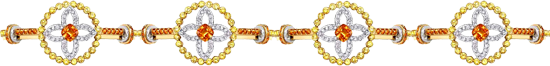

Derrière la
saleté,
S'étalant devant nous,
Derrière les yeux plissés
Et les visages mous?
Au-delà de ses mains
Ouvertes ou fermées
Qui se tendent en vai
Où qui sont poing levés
Plus loin que la misère,
Il nous faut regarder.
Il nous faut regarder,
Ce qu'il y a de plus beau,
Le ciel gris ou bleuté,
Les filles au bord de l'eau,
L'ami qu'on sait fidèle,
Le soleil de demain,
Le vol d'un hirondelle,
Le bateau qui revient.
L'ami qu'on sait fidèle,
Le soleil de demain,
Le vol d'un hirondelle,
Le bateau qui revient.
Par-delà le concert,
Des sanglots et des pleurs,
Des hommes qui ont peur.
Par-delà le vacarme,
Des rues et des chantiers,
Des sirènes d'alarme,
Des jurons de charretiers,
Plus fort que les enfants,
Qui racontent les guerres,
Et plus fort que les grands,
Qui nous les ont fait faire.
Il nous faut écouter,
L'oiseau au fond des bois,
Le murmure de l'été,
Le sang qui monte en soi,
Les berceuses des mères,
Les prières des enfants,
Et le bruit de la terre,
Qui s'endort doucement.
Les berceuses des mères,
Les prières des enfants,
Et le bruit de la terre,
Qui s'endort doucement.
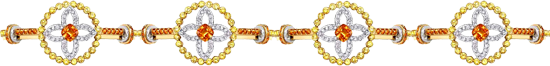

S'étalant devant nous,
Derrière les yeux plissés
Et les visages mous?
Au-delà de ses mains
Ouvertes ou fermées
Qui se tendent en vai
Où qui sont poing levés
Plus loin que la misère,
Il nous faut regarder.
Il nous faut regarder,
Ce qu'il y a de plus beau,
Le ciel gris ou bleuté,
Les filles au bord de l'eau,
L'ami qu'on sait fidèle,
Le soleil de demain,
Le vol d'un hirondelle,
Le bateau qui revient.
L'ami qu'on sait fidèle,
Le soleil de demain,
Le vol d'un hirondelle,
Le bateau qui revient.
Par-delà le concert,
Des sanglots et des pleurs,
Des hommes qui ont peur.
Par-delà le vacarme,
Des rues et des chantiers,
Des sirènes d'alarme,
Des jurons de charretiers,
Plus fort que les enfants,
Qui racontent les guerres,
Et plus fort que les grands,
Qui nous les ont fait faire.
Il nous faut écouter,
L'oiseau au fond des bois,
Le murmure de l'été,
Le sang qui monte en soi,
Les berceuses des mères,
Les prières des enfants,
Et le bruit de la terre,
Qui s'endort doucement.
Les berceuses des mères,
Les prières des enfants,
Et le bruit de la terre,
Qui s'endort doucement.